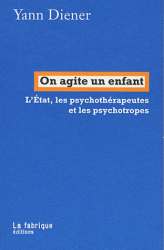Billet invité - Originellement paru dans le numéro 7 de la version papier d’Article11
Votre enfant est agité ? Vous vous sentez un peu dépassé ? Pas de problème, on va « gèrer » ces « troubles » à coups de cachetons... Ainsi s’avance le traitement psychiatrique contemporain, à rebours de toute prise en compte de la complexité des sujets.
En arrivant aux États-Unis, Freud aurait dit qu’il apportait la peste aux Américains en glissant la psychanalyse dans ses bagages. En retour, les États-Unis nous amènent aujourd’hui les thérapies cognitivo-comportementales1, avec l’immense marché des « troubles » et des médicaments qu’elles inventent. Dans le champ médico-social, plus particulièrement dans les Centres médico-psychopédagogiques (CMPP) financés par la Sécurité sociale, les psychanalystes qui accueillent des enfants, des adolescents et leurs parents résistent encore à la tentation de considérer leurs patients comme des « fauteurs de troubles » qu’il faudrait « traiter », « évaluer »... « dresser ». Entretien avec Yann Diener, l’un des « tranquilles ouvriers de la parole » qui « s’activent dans ces joyeuses niches »2 que sont les CMPP, psychanalyste et auteur de l’ouvrage On agite un enfant : l’État, les psychothérapeutes et les psychotropes3.
Certains textes produits par des psychanalystes peuvent avoir une portée politique. Vous avez fait le choix de publier à La Fabrique, maison d’édition agissant dans le champ de la critique sociale et politique...
J’avais invité l’éditeur de La Fabrique, Éric Hazan, à intervenir lors des journées de la fédération des CMPP suite à la sortie de son livre, LQR4. Nous voulions travailler sur l’apparition et l’imposition d’un nouveau langage médico-social, et j’avais envie que l’on parte de son travail à lui, plus large, sur la langue, pour ne pas rester entre psys à parler de ce sujet. Éric Hazan était justement en train de travailler avec le groupe du Manifeste pour la psychanalyse5 qui propose une analyse critique des conséquences6 du pacte noué par les psychanalystes avec l’État.
Ces deux publications à La fabrique ont lieu à un moment où de plus en plus d’analystes pensent qu’il n’y a pas une opposition si marquée entre l’acte analytique et l’acte politique, si l’on considère que le symptôme est un petit grain de sable dans le système familial ou plus largement dans la sphère sociale. Il serait réducteur de dire que le symptôme est un acte politique, mais la question de la portée insurrectionnelle du symptôme ouvre le débat.
Comment expliquez-vous l’existence d’une certaine forme de défiance vis-à-vis de la psychanalyse dans les milieux militants ?
C’est comme s’il existait une contradiction à la base – pas tellement théorique, mais sur le mode d’action : avec la caricature de la psychanalyse qui se replie sur le sujet (« c’était pour des bourgeois viennois qui avaient des problèmes de riches ») et du marxiste ou du post-marxiste qui n’est qu’un contestataire.
Je pense que la publication à La Fabrique permet d’un peu faire tomber ces oppositions. Ce qu’on voulait faire, c’était adresser ce travail à d’autres lecteurs en portant la critique au niveau du langage. Les instituteurs s’en servent par exemple pour puiser des arguments dans d’autres champs ; je voulais justement que le livre puisse être transposé à d’autres champs de pratique. La psychanalyse, ce n’est pas juste un cabinet et quelqu’un qui a beaucoup d’argent et qui vient se plaindre. La psychanalyse, c’est par exemple ce qui se passe dans les CMPP avec les enfants qui viennent en consultation. Les gamins eux-mêmes disent parfois : « Ah mais c’est ça, alors, tu es psychanalyste ? Je pensais que ça avait une longue barbe, un psychanalyste ! Il y a pas de divan ? On peut pas s’allonger ? »
Pourquoi ce titre, On agite un enfant ?
Il s’agit d’une reprise du titre de Freud Ein kind wird geschlagen, qui a été traduit par On bat un enfant et par Un enfant est battu. L’idée, dans ce livre, est de démonter la logique de l’agitation de l’enfant en montrant qu’on y participe – le on désignant les personnes qui pensent avoir de bonnes solutions pour calmer les enfants. Le premier chapitre parle de ce qui se passe à l’école, où le nombre d’enfants « agités » augmente. Il s’agit aussi du moment où l’institution scolaire impose une pression croissante sur l’enfant. Il y a toujours eu une pression scolaire (il faut être bon à l’école) mais elle s’exprime aujourd’hui d’une autre manière, par la transposition du langage et des techniques entrepreneuriales dans le milieu scolaire. Les analystes ont pour hypothèse l’idée selon laquelle le contexte familial – et plus largement, institutionnel – participe de l’élaboration du symptôme qui peut être, dans ce cas, l’agitation. L’enfant, en choisissant d’exprimer certains symptômes, réagit à l’emprise de sa famille ou de l’école, refuse la place qui lui est assignée, se fait porte-parole de malaises qui le dépassent (familiaux, par exemple), malaises qu’on lui enjoint de ne surtout pas formuler en lui disant de « tenir en place ». Plusieurs facteurs participent de ce qu’on appelle « un trouble » mais que l’on désigne trop rapidement comme quelque chose qui vient de l’enfant uniquement.
Vous citez aussi Freud en exergue de votre livre : « On cède d’abord sur les mots et puis peu à peu aussi sur la chose »...
Un certain nombre d’instituteurs et de pédopsychiatres pensent que la maladie de l’enfant « agité » (le TDAH, soit trouble déficit de l’attention/hyperactivité) existe et qu’il faut donc trouver le bon médicament pour le soigner. Ou plutôt, le bon circuit neuronal et la molécule qui convient. TDAH est un sigle passé dans le langage médico-social qui apparaît maintenant dans le discours des enfants : eux-mêmes commencent à penser que cela existe. Depuis quelque temps, on reçoit des enfants qui disent « je suis TDAH » ou « je suis un petit peu TDAH », comme en psychiatrie on entend des personnes dire « je suis schizophrène ». L’enfant pense que c’est parce qu’il est agité qu’il y a un malaise dans la famille ou dans la classe, et les parents, de plus ou moins bonne foi, pensent que c’est parce que l’enfant est agité qu’eux-mêmes sont en difficulté, qu’ils ne dorment plus, etc... Or, quand une personne intègre le stigmate, dit qu’elle « est » cela (plutôt que d’utiliser une phrase plus longue pour se définir : « Je souffre de troubles qui s’apparentent à ... »), la personne ne parle pas d’elle : elle se cache derrière la désignation, elle répond à l’attente des autres.
Dans la novlangue psychothérapeutique, on ne parle d’ailleurs plus de « symptôme » mais de « handicap »...
Il s’est opéré un glissement significatif entre « cet enfant souffre d’un trouble de la concentration » et « il est agité, il est comme ça ». Le remplacement de « symptôme » par « handicap » revient à nier l’expression et l’autonomie du sujet. Dans ses textes fondamentaux, Freud montre que les symptômes, les actes manqués et les rêves participent de l’expression de l’inconscient. Le symptôme est une solution du sujet pour faire un compromis entre le normal et le pathologique, entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, entre les désirs et l’interdit. Le symptôme permet de dire et de ne pas dire. Bref, le symptôme est une invention du sujet alors que le handicap est une invention de l’institution. Il s’agit de deux créations, sauf qu’une des deux est imposée à la personne.
Jusqu’à présent, entamer une analyse est une démarche qui relève d’une décision de la personne. Il est vrai que les enfants sont a priori amenés au CMPP à partir du constat que quelque chose ne va pas bien, souvent en tant que fauteurs de trouble. Ils se défont très rapidement de cette assignation en montrant qu’ils ont d’autres plaintes qui ne concernent pas directement le motif pour lequel ils ont été amenés au CMPP. La première demande, le symptôme, cache une autre demande. Et ça ne prend pas tant de temps pour que les choses se déplient, au CMPP, pour retourner les liens de causalité.
Comme vous l’expliquez dans votre livre, l’obtention d’un auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour un élève est aujourd’hui conditionnée par la reconnaissance du statut de handicapé.
Jusqu’à présent, les parents pouvaient choisir pour leur enfant. Mais pour des raisons de financement, les demandes d’AVS ne sont désormais acceptées que si un dossier a été constitué auprès de la Maison départementale des personnes handicapées. Certains parents ne demandent donc plus d’AVS alors que ça pourrait être utile à leur gamin.
Dans le même sens, la fédération des CMPP a beaucoup lutté pour que ne soit pas appliquée aux Centres médico-psychopédagogiques une durée maximale de consultation de six mois pour les enfants. Le symptôme doit avoir le temps de se déplier dans toutes ses composantes – ça ne veut pas dire que ça prend dix ans : il faut prendre un minimum de temps avec les gamins. Grâce à notre travail d’explicitation, les gens qui siègent dans les commissions régissant l’action médico-sociale ont compris ceci : si au bout de six mois de consultation en CMPP, un enfant voulait continuer le travail, il fallait qu’il ait le statut de « handicapé », et ce, quelle que soit sa pathologie. L’idée de handicap était jusqu’alors déterminée par une durée de traitement ; nous avons finalement obtenu que ça ne se passe pas de cette façon.
Vous écrivez que laisser s’exprimer le symptôme, c’est laisser s’exprimer une part de rébellion du sujet...
L’analyste ne s’attache pas à supprimer le symptôme, qui n’est pas uniquement un truc mauvais, qui l’embête ou qui embête les autres, mais une solution de compromis. C’est pour ça que ça tient, un symptôme : tant qu’il « aide », ça va, jusqu’à ce qu’il devienne insupportable. Dans le symptôme il y a une part de soumission qui fait que l’on n’arrive pas à faire certaines choses et en même temps une part de symbole qui permet de dire, de ruer dans les brancards, d’embêter les autres. Le principe de l’analyse, c’est de modifier son rapport avec ce symptôme-ci, non pas de le faire disparaître d’un coup puisqu’il signifie quelque chose.
L’idée, avec les pratiques médicamenteuse et comportementaliste – c’est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) – est de faire revenir le patient à son état d’avant la maladie. Ce qui est un problème : si l’on revient à l’état d’avant le symptôme, on revient aux conditions qui ont permis l’apparition du symptôme. C’est tout à fait assumé par les labos qui fabriquent les médicaments : « Nous pouvons enlever votre symptôme », disent-ils. C’est vrai, ça marche. Un conditionnement, une hypnose ou un médicament éradiquent l’expression du symptôme. Sauf que bien souvent, un autre symptôme se forme, ou le symptôme se déplace (dans la famille, un autre enfant se « charge » d’exprimer le malaise). Disons qu’à court terme, les résultats sont évidents avec ces méthodes-ci, mais je considère qu’à long terme, les conséquences seront plus coûteuses pour le sujet et en terme de lien social.
On a souvent caricaturé la psychanalyse en disant qu’elle ne s’intéresse pas à la souffrance de la personne, qu’elle ne fait que tourner autour ou valoriser le symptôme ou encore qu’il ne s’agit pas d’une thérapie. Bien entendu, c’est faux, on le vérifie tous les jours, au CMPP ou ailleurs, il s’agit de traiter de profondes souffrances, non pas réductibles à des « bobos à l’âme » mais à des questions de vie ou de mort, plus ou moins directement. L’analyse peut viser la levée du symptôme mais dans un deuxième temps. Une fois qu’il a pu se déplier avec ses bénéfices et ses coûts et qu’à ce moment-là, on choisit de le garder ou pas. Certes, cela nécessite du temps. Or le temps est une dimension complètement niée dans l’approche comportementaliste.
Dans tous les cas, il y a un intérêt idéologique et pratique sur le court terme à appréhender le symptôme autrement que comme il l’est fait dans la psychanalyse : si les désirs se réalisaient tous en même temps, ce serait difficile pour le lien social. C’est une entreprise de refoulement qui est en partie salutaire mais qui permet beaucoup de soumission et de domination. La logique d’État va plutôt dans le sens d’une répression de cette rébellion qui est une partie du symptôme. Il est donc logique que la réponse au symptôme soit plutôt de l’ordre de son éradication ; s’il y a de l’insurrection, même si elle se situe au niveau du sujet, il y a toujours une opposition entre une logique répressive et une logique préventive. Et la réponse de l’État, c’est plutôt la répression ou l’évaluation – qui est une autre forme disant « ce qu’on peut faire » et « ce qu’on ne peut pas faire ».
La logique d’évaluation par l’État que vous décrivez dépasse le cadre des CMPP : elle est également à l’œuvre dans le champ de l’éducation spécialisée...
C’est une logique binaire : aucune variation n’est possible. Dans les derniers textes de 2002 qui régissent le médico-social, le terme de « symptôme » n’apparaît plus, pas plus que dans les manuels nosographiques7. Les termes de « sujet », de « malade » ou de « patient » n’apparaissent plus. Ils sont parfois remplacés par le mot « client » ou par le mot « usager » quand demeure un vague vernis de service public. C’est comme à la RATP : c’est le même terme. Il y a des « usagers » qui ont – au mieux – des « troubles » ou un « handicap ». Il existe là un renforcement de ce clivage « normal/pathologique » qui fait que, quand vous devez remplir des cases ou des grilles, vous avez à cocher – d’une certaine façon – « normal » ou « pathologique ». Mais attendez, c’est plus compliqué... Ça ne rentre pas dans un logiciel, il y a le contexte...
Le texte de référence des thérapies cognitivo-comportementales s’appelle le DSM8 : en inventant des maladies, il invente de façon concomitante des médicaments...
Le DSM fait disparaître l’idée de symptôme, il prend chaque signe pour une maladie en soi, pour une pathologie. Par exemple, les catégories classiques de « névrose » ou d’« hystérie » n’existent plus. Chaque signe – le rituel, le TOC9 : c’est la maladie. On ne traite plus le symptôme, on traite le signe. Effectivement, on peut éradiquer le signe, on l’efface, il s’efface. Si vous continuez avec l’idée de névrose, vous ne pouvez pas : on sait qu’on ne peut pas sucrer la névrose. Cette disparition de la « névrose » dans la classification est aussi une attaque de cette complexité entre le « normal » et le « pathologique ». Il y a des molécules qui font disparaître un délire alors que le délire dit quelque chose du sujet. Le délire est en effet éradiqué par les molécules des antipsychotiques. D’ailleurs, le terme est extraordinaire : avant on disait « neuroleptiques », là ce n’est plus une molécule anti-délire mais c’est une molécule « anti-psychotique » : contre le psychotique lui-même. Les gens disent : « Je suis psychotique, je prends un antipsychotique. » C’est contenu dans les mots.
À l’invention des « troubles du comportement » telle que l’ « hyperactivité » chez l’enfant correspond une réponse médicamenteuse connue sous le nom de Ritaline. L’ État encourage-t-il à l’école la systématisation de cette réponse ?
Le passage ne s’est pas encore fait en France. Dans les formations, les instits sont incités à détecter, à diagnostiquer le TDAH. Là, le mot est utilisé. La conséquence est simple : il faut de la Ritaline. Ce n’est pas écrit mais c’est dit par des directeurs d’établissements scolaires. J’en ai même entendu dire à des parents : « Si vous ne mettez pas votre enfant sous Ritaline, on ne le garde pas à l’école. » En revanche, en Allemagne, les labos viennent faire la promotion de la Ritaline dans les écoles – qu’ils peuvent subventionner par ailleurs. Là-bas, c’est considéré comme un service, comme un plus.
ll existe pourtant des risques liés à la prise de Ritaline, relevés notamment par la revue médicale indépendante Prescrire.
Il y a des risques cardiovasculaires, sur la croissance et la maturité sexuelle, ainsi que des risques de troubles neurologiques. Les États-Unis commencent d’ailleurs à faire attention à cela parce que des procès sont intentés et que ça va leur coûter de l’argent. Jusqu’à maintenant en France, on ne pouvait pas prendre de Ritaline avant six ans, mais le seuil vient d’être abaissé au moment même où l’AFSSAPS10 fait entrer la Ritaline dans sa liste de médicaments à surveiller. Ça sent le scandale sanitaire. Dans le même temps, un changement a été opéré pour faciliter la prescription de Ritaline : ce n’était avant possible qu’à l’hôpital, car la Ritaline est considérée comme un stupéfiant. Et en ce moment, les labos cherchent un nom pour un médicament destiné à traiter les adultes « agités ». C’est dans leurs cartons.
1 Thérapies inventant des « troubles » à « traiter » à court terme, faisant fi de l’histoire du sujet et des ressorts inconscients du symptôme pour lequel l’individu consulte.
2 Phrase piochée dans le livre de Yann Diener.
3 La Fabrique, 2011.
4 Éric Hazan, LQR, la propagande au quotidien, Raison d’agir, 2006.
5 La Fabrique, 2010.
6 Selon les signataires du Manifeste pour la psychanalyse : « Les réponses proposées dans le champ de la santé sont préférentiellement orientées vers des solutions techniques standardisées qui se juxtaposent : à la prescription massive de psychotropes, on ajoute désormais la prescription de parole (deuils, traumatismes, viols, harcèlement, etc.). Il s’agit aujourd’hui d’enserrer cette proposition sociale de « psychothérapie » dans les règles bureaucratiques qui déferlent dans le champ médical. »
7 Ce qui a trait à la description et à la classification des troubles et des maladies.
8 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ou Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.
9 Trouble obsessionnel compulsif.
10 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.